|
Photo : Emile VIGNES entre 1920 et
1930
Le travail de gemmage est un travail
saisonnier, comme tout travail agricole, mais aussi familial.
Il comprend trois périodes distinctes :
-
La préparation des pins, effectuée par le
résinier aidée normalement de sa femme ;
-
les « piques » faite par l’homme ;
-
les « amasses » effectuées par tous les
deux.
Les enfants contribuent aussi bien aux travaux de
préparation que de récoltes.
Les pots vidés avec la « palique », dans la
couarte. Au pied du pin, les « gemmelles ».
02 – Outils du Gemmier
Source : gemmage du pin maritime par M. A. VIOLETTE –
1900 disponible sur Gallica
1. Grand Pitey – 2. Hapchot à échelons – 3. Hapchot – 4. Sarcle à
pela – 5. Sarcle à brasqua ou barrasquite – 6. Pousse-crampon – 7.
Maillet – 8. Attrape-pot – 9. Escouarte – 10. Hachère ou tos – 11.
Perrus – 12. Peyre à aguada est son affiloir – 13. Tronc de pin
14. Crampon – 15. Pot – 16. Quarre – 17. Saley et pantchotte – 18.
Broc – 19. Troupès – 20 Toupin - 21. Regen – 22. Graoupeou ou croc
– 23. Couvercle à pot – 24. palique
03 - Gemmage au Crot
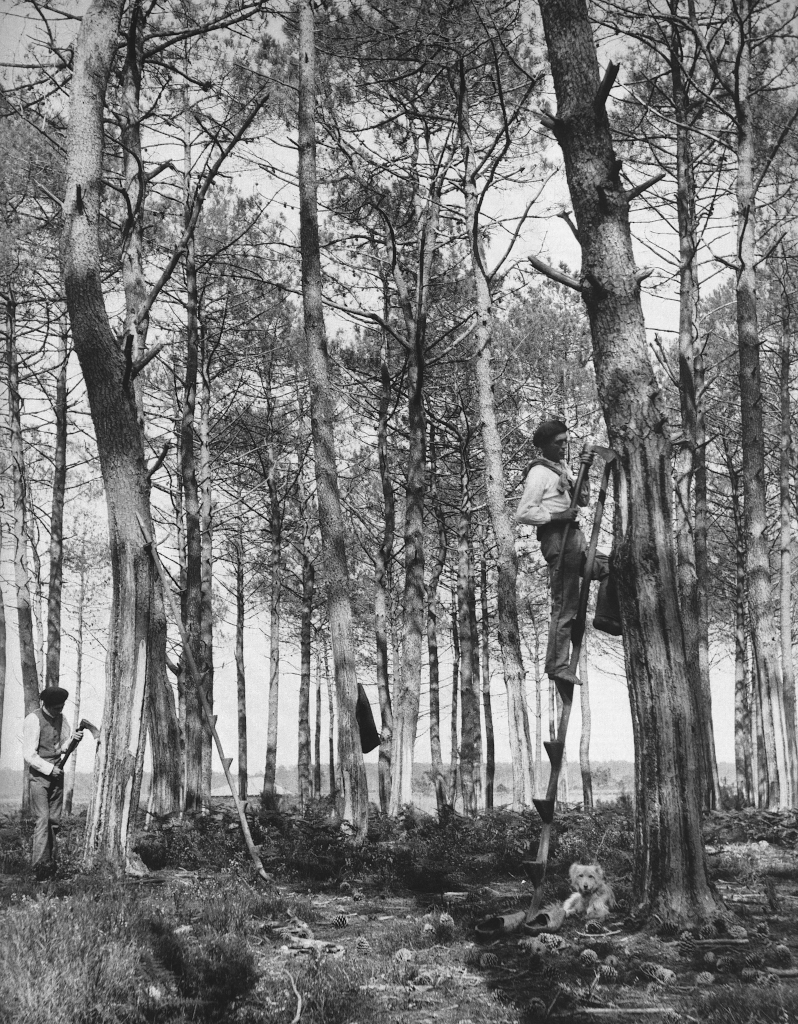
Photo : Félix ARNAUDIN résiniers au travail le 15 Octobre
1891 à Commesnsacq
De l’antiquité à 1860, le gemmage se pratiquait sur les pins de
plus de 60 ans. Le gémmier commençait par établir un
« crot », c’est à dire un trou au pied de l’arbre ,
qu’il tapissait de mousse et gazon bien tassés et au dessus duquel
avec la hâche d’abord puis le hapchot ensuite, il faisait une
incision par laquelle s’écoulait la gemme. Le « pitey »
est une sorte d’échelle à un seul montant comportant des petites
marches taillées dans la masse d’une perche en bois, permettait de
gemmer en hauteur..
04 - Raclage de l’écorce
Source : M. SAYO – GRAYAN
Au mois de février, il faut « parer »
le
pin, c'est-à-dire enlever l’écorce dure, à la cognée pour les
parties basses.
05 - Raclage de l’écorce
Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur - Août 1980
Lorsque le travail se situe à hauteur d’homme, le raclage se
réalise avec un outil nommé barrasquit
d’espourga.
06- Pique au Hapchot
Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur - Août 1980
La pique est l'incision faite périodiquement en haut de la
care par les résiniers (gemmeurs, gemmiers).
Elle consiste à entretenir la care,
c'est-à-dire entailler de nouveau le pin maritime grâce à un
outil spécifique (, le hapchot »pour
raviver la blessure et assurer un débit de résine suffisant.
Afin que la résine coule régulièrement, il
faut rafraîchir les cares toutes les semaines en progressant
de quelques centimètres vers le haut à chaque pique. Les
copeaux qui tombent sont appelés des « gemelles ou
galips » et sont gardés pour
allumer le feu.
La profondeur de la care ne doit pas excéder
1 cm.
07 - Hapchot
Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur - Août 1980
Le hapchot n’est pas une hache mais une lame
en forme de col de cygne fixée à un manche, servant à
« rafraîchir » la care.
Le gemmeur ou gemmier avec son outil
extrêmement tranchant, dont le taillant courbe pratique des
incisions concaves, fait sauter quelques minces copeaux de
bois, de manière à élever l'entaille ou quarre d'environ un
centimètre.
La légèreté
de ce geste a donné lieu à une expression : har
siular lo hapchòt :
« faire siffler le hapchot » (Simin
Palay,
Escole Gastoû Febus, Dictionnaire du gascon et du béarnais modernes, Paris, CNRS (ISBN 2-222-01608-8)).
Pour les cares hautes le gemmeur utilise le « rasclet »,
sorte de fer de hapchot, monté, en mode de grappin, à
l'extrémité d'un long manche.
08 – Affûtage

|
Photo : Jacques CHAMBON : M. MIREMONT – Azur -
Août 1980
L'affûtage du hapchot est essentiel
pour maintenir son efficacité. Comme pour tous les
outils de travail du bois, le tranchant doit être
parfait.
Cette opération, réalisée plusieurs
fois par jour est effectuée à l’aide de plusieurs
pierres de grains différents.
Le gemmeur peut vérifier la qualité
du tranchant en se rasant les poils.
|
09 – Pot Hugues
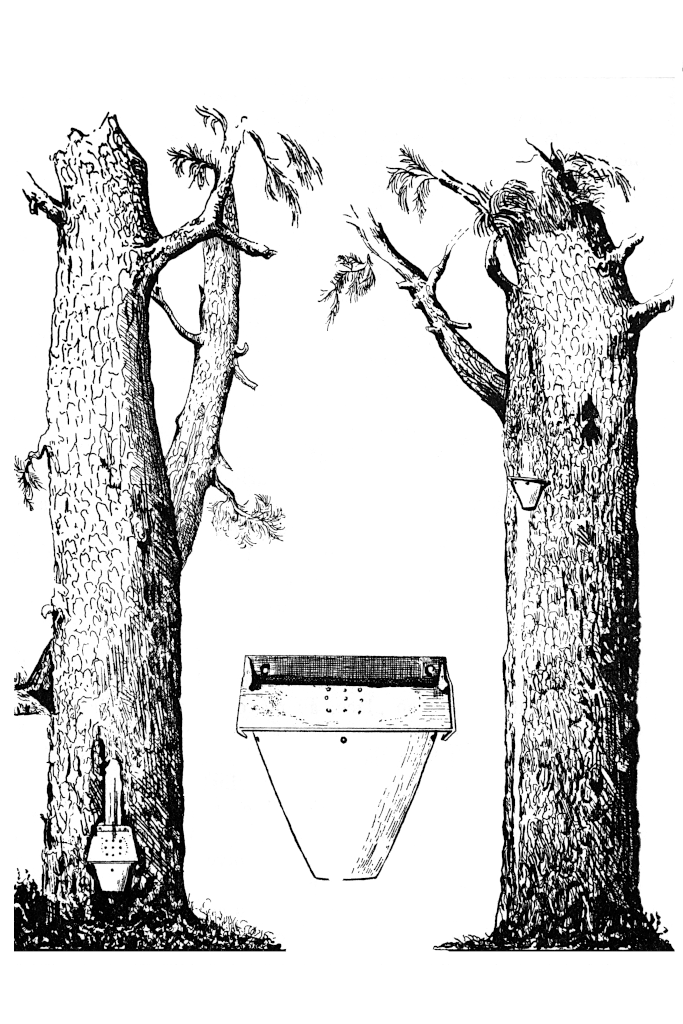
Source : Contribution à l’histoire du boisement des
landes de Gascogne – Roger SARGOS -Delmas 1949 p 482
Pour améliorer la qualité de la gemme récoltée, Pierre
HUGUES, avocat bordelais a fait breveter pour 15 ans, en 1844
« un nouveau système d’extraction des résines à
l’aide d’un réservoir ou récipient ascensionnel à
déversoir avec couvercle concave à tiroir et à filtre
s’élevant avec la carre et recevant la matière résineuse à
sa sortie immédiate de l’arbre. ».
Après l’expiration du brevet, en 1860, l’utilisation du pot
de terre déplaçable chaque année le long de la care, s’est
généralisé.
10 – Pose du pot

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt
communale – Soustons - Août 1980
Le pot de résine est disposé en bas de la
care.
Il est fixé par le haut avec un « crampon »
en
zinc qui est accroché dans l’écorce à l’aide du « pousse
crampon ».
Il est retenu à sa base par un clou qui est
enfoncé au marteau.
11 – Plat à résine

Photo : Jacques CHAMBON : Forêt communale – Soustons -
Août 1980
Lorsque le pin est penché , la récolte ne peut se faire à
l’aide du pot.
On dispose alors parterre à l’aplomb de la
carre un récipient beaucoup plus large : le plat.
12 - Gemme
Photo : Jacques CHAMBON : Forêt communale– Soustons -
Août 1980
Toutes les cinq semaines environ, pendant l'écoulement de
printemps et d'automne, toutes les trois semaines pendant
l’été, l'homme vient transvaser dans la mesure la « couarte »,
seau d'une vingtaine de litres, la gemme, partie la plus
fluide de la térébenthine qui s'est accumulée
dans les pots.
En même temps, à l'aide d'une curette la
« palique », il détache la pâte molle,
communément désignée sous le nom de galipot,
qui s'est déposée contre le crampon et contre la partie
adjacente de la quarre; mélange ce galipot à la gemme et
obtient ainsi la résine.
13 – Amasse
Photo : Félix ARNAUDIN : 3 février 1918 à Commensacq
Les résiniers stockent la récolte de résine dans un bassin
rectangulaire « la barque », creusée dans le
sable.
Une femme porte sur la tête « l’escouarte »,
récipient
à résine.
Les deux autres vident leur escouarte dans la
barque.
Le petit abri couvert de brande sert à
abriter les outils, voire le résinier en cas de pluie.
14 – Barrique Chalosse
Photo : Jacques CHAMBON : Forêt communale – Soustons -
Août 1980
La gemme récoltée dans les pots et les plats
était déversée dans un barrique de 340 litres qui était une
adaptation de la barrique de vin utilisée dans le pays de
« Chalosse ».
Dans un premier temps elle était en bois,
puis au XXème siècle elle était en zinc.
Pour faciliter l’amasse la barrique possédait
une trappe.
Les barriques une fois remplies pouvaient être acheminées vers
l’usine de distillation.
15 - Cabane de résinier
Photo : Jacques CHAMBON : Forêt
communale – Soustons - Août 1980
|